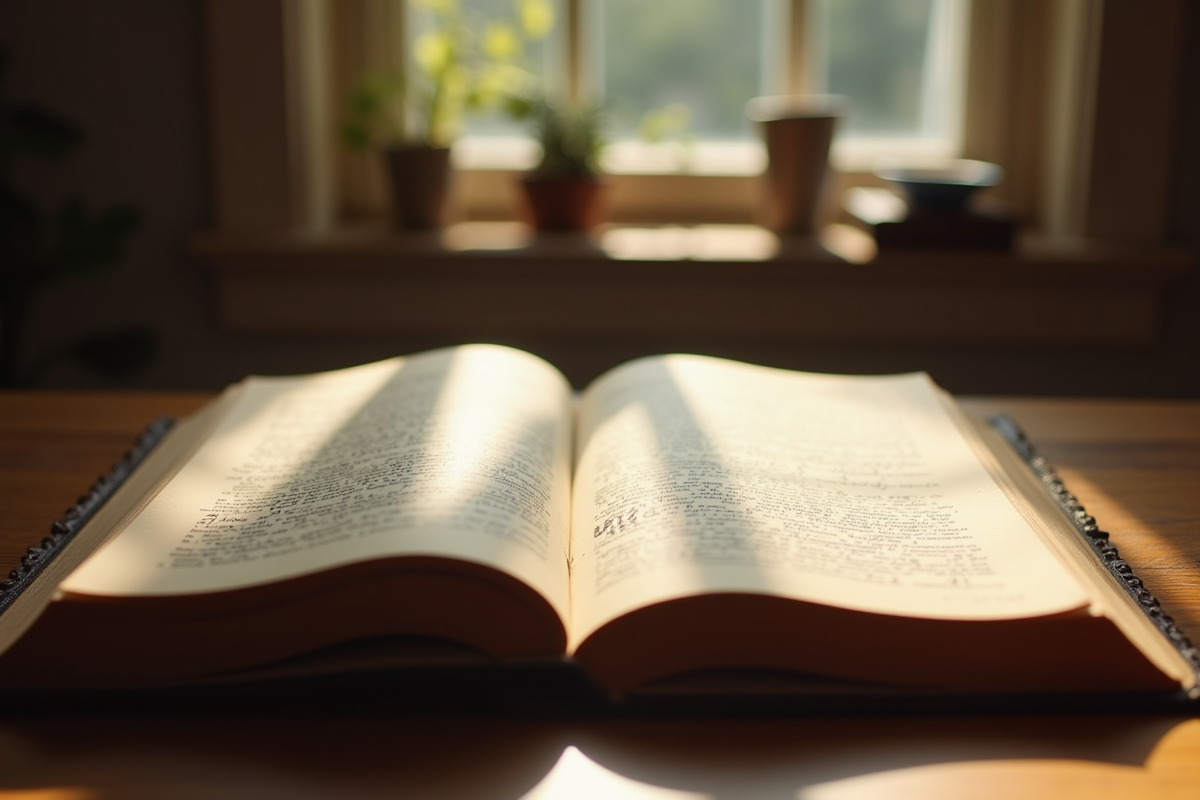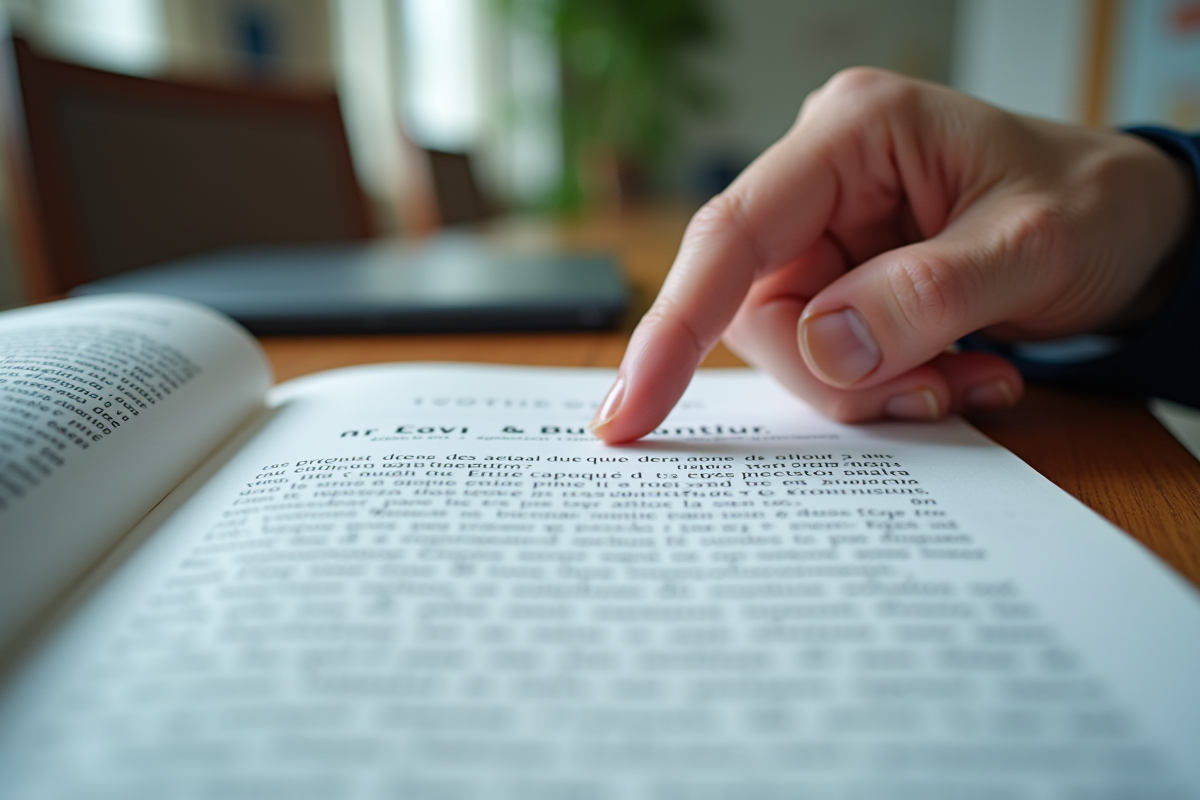Deux siècles d’histoire, trois phrases, un principe qui a façonné la vie contractuelle française : l’article 1134 du Code civil, dans sa version d’origine, disposait que les conventions ainsi formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Ce principe, pilier du droit des contrats, a traversé plus de deux siècles sans modification majeure avant d’être réécrit lors de la réforme du droit des obligations en 2016. Sa portée a suscité débats et interprétations, notamment sur la question de la force obligatoire du contrat et l’exigence de bonne foi.
La force obligatoire du contrat : un principe fondateur du Code civil
Dès 1804, l’article 1134 du Code civil a posé un cadre solide : la force obligatoire du contrat devient la règle du jeu. La fameuse formule, « les conventions ainsi formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », ne laisse aucune place au doute. Ici, la volonté des parties prime, balayant toute idée que le contrat serait un simple accord de façade. Signer, c’est s’engager avec la même rigueur qu’une loi. Cette exigence irrigue la vie économique, balise les relations sociales, et forge un climat de confiance entre partenaires.
Le texte allait plus loin : impossible de revenir en arrière sans un véritable accord ou sans raison prévue par la loi. Cette intangibilité du contrat verrouille les engagements et protège la stabilité des rapports juridiques. Personne ne peut s’échapper d’un contrat simplement parce que le vent a tourné. La bonne foi, inscrite à l’alinéa 3, s’impose alors comme un garde-fou : chaque partie doit respecter non seulement la lettre, mais aussi l’esprit de l’accord, sans arrière-pensée ni stratégie déloyale.
La réforme de 2016 a bouleversé la forme, mais pas le fond. Les anciens principes vivent désormais dans trois articles distincts : la force obligatoire (article 1103), la modification ou la révocation (article 1193), la bonne foi (article 1104). Désormais, la bonne foi n’est plus cantonnée à l’exécution : elle irrigue toutes les étapes du contrat, de la négociation à la rupture.
Ce changement de structure répond à un objectif de clarté : chaque règle a sa place, chaque principe sa portée. Mais la substance reste intacte. Un contrat n’est pas un engagement à la légère ; il a force de loi, sauf exception reconnue par le législateur. C’est la clef de voûte du droit des contrats français.
Pourquoi l’article 1134 a-t-il marqué l’histoire du droit des contrats ?
L’article 1134 du Code civil occupe une place à part dans la mémoire des juristes. Véritable point de passage obligé, il a donné toute sa force à la force obligatoire du contrat, fondant une culture juridique où la parole donnée engage. Chaque juge, avocat, étudiant a dû s’y confronter, le manier, le discuter. Si la France est devenue le pays du contrat, c’est en partie grâce à cette règle qui érige la loyauté et la stabilité en dogmes.
Le texte ne s’est pas contenté d’inspirer la doctrine : il a nourri la jurisprudence, inspiré des générations de juges et d’universitaires, et balisé la frontière entre liberté contractuelle et bonne foi. Grâce à lui, le compromis s’est imposé : garantir la solidité des conventions, tout en autorisant leur adaptation si le contexte l’exige. Jusqu’à la réforme de 2016, l’article 1134 servait de boussole en matière de contrats. Sa disparition du Code au 1er octobre 2016 n’a pas effacé son héritage : ses principes irriguent désormais les articles 1103, 1193 et 1104.
L’effacement de l’article 1134 n’a rien d’un effacement. Au contraire, son esprit demeure, disséminé dans plusieurs dispositions. C’est la marque d’une continuité : le droit des contrats français continue de s’appuyer sur les mêmes piliers, mais les affiche désormais plus distinctement. La réforme a modernisé le cadre, sans en bouleverser les fondations. Plus qu’un vestige, l’ancien article 1134 reste la pierre d’angle d’une tradition juridique toujours vivante.
Entre liberté contractuelle et bonne foi : quelles obligations pour les parties ?
Après la réforme de 2016, trois articles structurent ce qui fut l’âme de l’article 1134. Voici comment chacun d’eux façonne les droits et les devoirs des contractants, à chaque étape du parcours :
- Article 1103 : « Les contrats ainsi formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La volonté exprimée dans le contrat lie les parties, sans échappatoire possible sans raison valable.
- Article 1193 : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » La stabilité prévaut, empêchant toute remise en cause unilatérale de l’équilibre trouvé.
- Article 1104 : La bonne foi irrigue l’ensemble du processus contractuel. Elle ne s’arrête pas à la signature : de la négociation à l’exécution, cet impératif s’impose à tous, sans exception possible.
La liberté de contracter ne signifie pas pouvoir tout se permettre. L’engagement doit être suivi d’actes conformes à la confiance placée par l’autre partie. La prohibition des engagements perpétuels offre à chacun la garantie de ne pas rester prisonnier d’un lien sans fin. L’équilibre entre liberté et contrainte, au centre du droit des contrats, se vérifie à chaque étape, sous l’œil exigeant de la loyauté et de la transparence. Le droit français, loin de figer les positions, impose aux parties de tenir leurs engagements avec constance, mais aussi d’adapter leur comportement aux nécessités de la vie économique ou sociale.
De l’article 1134 à la réforme de 2016 : quelles évolutions pour la force du contrat ?
L’ordonnance du 10 février 2016, numéro 2016-131, a tourné une page sans clore l’histoire. L’unité textuelle de l’article 1134 disparaît au 1er octobre 2016, remplacée par une organisation plus lisible. La force obligatoire du contrat s’ancre à l’article 1103, la question des modifications et de la révocation s’installe à l’article 1193, tandis que la bonne foi occupe l’article 1104. Le législateur choisit ainsi de clarifier, d’expliciter et de distribuer chaque principe dans son espace propre.
Changement notable : l’ancien article 1134, qui faisait la part belle à la force de la volonté, se consacre désormais à l’erreur comme vice du consentement. Fini les formules générales, place à une répartition précise : chaque principe trouve son terrain, chaque règle sa portée. Cette redéfinition rend le droit des contrats plus lisible, sans pour autant ébranler ses fondations. Le principe cardinal demeure : le contrat lie, sauf exception expresse. Cette stabilité est contrebalancée par une capacité d’adaptation, plus conforme aux réalités actuelles.
Ce mouvement ne s’arrête pas au droit des contrats. La même logique a transformé la responsabilité civile : l’ancien article 1382 est devenu 1240, l’article 1384 s’affiche désormais sous le numéro 1242. Les numéros changent, la substance reste. Le Code civil poursuit sa métamorphose, avec la volonté de conjuguer héritage et modernité. L’histoire de l’article 1134, loin d’être un simple chapitre clos, continue d’imprégner le droit français, ligne après ligne, contrat après contrat.